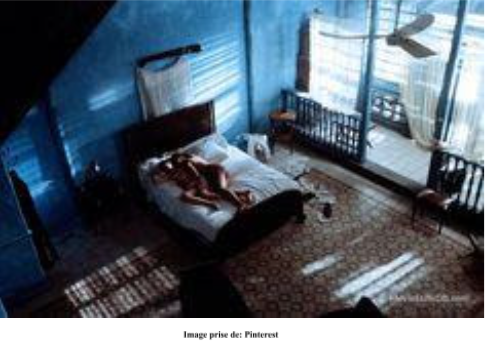Table Ronde :
Marginalisation et inégalités dans l'œuvre littéraire "L'amant" de Marguerite Duras
Par: David Alejandro Londoño Marín, Camilo Londoño Rendón, David Ibarra Bedoya, David Alejandro Giraldo Orozco
Présentation
Introduction
Camilo Londoño: Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui nous aurons une table ronde où nous discuterons des questions de marginalisation et d'inégalité dans le livre L'amant de Marguerite Duras. Chaque participant aura trente secondes, maximum une minute, pour partager avec les autres ses pensées et sa connaissance sur le thème. Les participants doivent respecter les autres pour que l'on puisse avoir une bonne communication et comprendre mieux aux collègues.
Les participants de la table ronde sont Alejandro Giraldo Orozco, David Ibarra Bedoya, David Alejandro Londoño et moi-même, Camilo Londoño. Nous avons pris quelques citations littérales du livre dans lesquelles la marginalisation et l'inégalité sont évidentes. Nous allons les analyser et les discuter.
Les règles de cette table ronde sont :
-
Chaque participant aura trente secondes, maximum une minute, pour partager avec les autres ses pensées et sa connaissance sur le thème.
-
Les participants doivent respecter les autres pour que l’on puisse avoir une bonne communication et comprendre mieux aux collègues.
Premièrement je vais vous donner les définitions d’inégalité et d'exclusion sociale.
Explication
L’Inégalité sociale est une différence dans l’accès à des ressources sociales rares et valorisées, ressources étant entendu au sens le plus large, incluant toutes les possibilités d'actions humaines : politique, économique, culturelle, sociale, sexuelle, etc.
L'exclusion sociale est la relégation ou marginalisation sociale d'individus, ne correspondant pas ou plus au modèle dominant d'une société, incluant personnes âgées, personnes sujettes à un handicap (physique ou mental) ou autres minorités. Elle n'est généralement ni véritablement délibérée, ni socialement admise, mais constitue un processus plus ou moins brutal de rupture parfois progressive des liens sociaux.


Analyse

Camilo Londoño:
Alors, le premier exemple que j’ai pour vous est cette phrase de la page 88 : « La directrice a accepté parce que je suis blanche et que, pour la réputation du pensionnat, dans la masse des métisses il faut quelques blanches. » (Marginalisation et inégalité)
Dans cette phrase, nous pouvons voir un exemple clair d'inégalité, dans lequel Marguerite est privilégiée par rapport au reste de ses camarades de classe simplement parce qu'elle est blanche, et préserver ainsi la réputation de l'école, ce qui lui permet d'éviter plusieurs règles, parmi lesquelles les horaires de sortie et d'entrée dans l'école.
Il semble qu'une école ne comptant que des élèves métis n'était pas considérée comme prestigieuse ou au même niveau que les autres. Il est clair que les personnes métisses étaient marginalisées, considérées par la majorité comme inférieures, et tout au long du livre, nous voyons d'autres scénarios de ce type, dont mes collègues parleront plus tard. Malheureusement, ce type d’attitudes étaient très courantes à l'époque et étaient tout à fait normales et acceptées. L'inégalité prévalait, et si ce n'était pas entre les races, c'était entre les classes sociales, les sexes, les rôles familiaux et les amitiés.
David Alejandro Giraldo:
En entendant de ton exemple je peux dire que les personnes sont données des règles de conduite spécifiques en dépendant de leur sexe et de leur classe sociale, et c’est pour ça que notre protagoniste a reçu ce traitement-là. Cependant, les femmes peuvent recevoir le même traitement même si elles sont blanches ou noires dans certains cas, et la partie du livre que je vais citer a-t-elle à voir avec ça :
« Elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinhlong. Pendant un an on ne l'avait pas vue à Vinhlong. À cause de ce jeune homme, administrateur-adjoint à Savannakhet. Ils ne pouvaient plus s'aimer. Alors il s'était tué d'un coup de revolver. » (Marginalisation) (Page 109).
-
« Chaque soir cette petite vicieuse va se faire caresser le corps par un sale Chinois millionnaire. » (Marginalisation) (Page 109-110)
-
« Un jour ordre leur sera donné de ne plus parler à la fille de l’institutrice de Sadec. » (Marginalisation) (110)
-
« Aucune ne lui adressera plus la parole. Cet isolement fait se lever le pur souvenir de la dame de Vinhlong. » (Marginalisation) (Page 110)
-
« La même différence sépare la dame et la jeune fille au chapeau plat des autres gens du poste. De même que toutes les deux regardent les longues avenues des fleuves, de même elles sont. Isolées toutes les deux. Seules, des reines. Leur disgrâce va de soi. Toutes deux au discrédit voué du fait de la nature de ce corps qu’elles ont, … » (Marginalisation) (Page 110-111)
Marguerite Duras a parlé dans les pages cent neuf à cent onze d’une femme qui venait du Savannakhet et que Marguerite appelait La Dame. Il n’est pas tout à fait clair pour moi, mais il parait que cette femme a fait l'objet d'un traitement discriminatoire à cause de son mariage avec un homme français et son suicide ultérieur produit de la marginalisation sociale. Comme je l’avais dit, ces détails ne sont pas explicites dans l'œuvre, c’est juste mon interprétation. Je pense que ce traitement pourrait avoir été causé parce que quand certaines femmes orientales s’associent avec des hommes blancs riches, elles sont d'une réputation mal intentionnée, elles sont vues comme des prostituées. Cette femme parait-elle vivre à côté du lycée, et Marguerite voit et réfléchi sur son cas. Notre jeune protagoniste a été étiquetée comme une prostituée pour le simple fait d’avoir une relation avec un chinois riche plus âgée qu’elle. Même si le chinois a été rejeté par son père, il n’a reçu le même traitement qu’une femme peut recevoir, comme nous le pouvons voir. Je crois que l’inégalité vers la femme dans l’histoire a-t-elle à voir avec non seulement l’inégalité entre les hommes et les femmes commun à l’époque mais peut-être aussi qu’elle a à voir avec le mélange culturel entre les françaises et les orientaux.
David Alejandro Londoño:
Et définitivement, dans tout l’œuvre cette division des blancs est évidente, et je considère que c’est un aspect important pour l’auteur, car tout au long de sa vie en Indochine elle, une femme blanche, a dû souffrir l’exclusion subie par les minorités dans tous les pays, car elle était une minorité dans ce pays, elle raconte tous les occasions où elle est traitée différemment pour sa peu, et aussi les comportements élitistes attribués à sa couleur, comme dans la phrase suivante:
« Mais nous, non, nous n'avions pas faim, nous étions des enfants blancs, nous avions honte, nous vendions nos meubles, mais nous n'avions pas faim, nous avions un boy et nous
Mangions, parfois, il est vrai, des saloperies (...) mais ces saloperies étaient cuites par un boy et servies par lui et parfois aussi nous les refusions, nous nous permettions ce luxe de ne pas vouloir manger. » (Page 13) (Marginalisation et inégalité)
Le fait qu’une personne doit suivre un type de conduite pour sa couleur de peau, et que la société impose certains modes de vie selon le lieu d'origine, l'idée de simuler un mode de vie que je ne peux pas me permettre, c’est un bon exemple des exigences de ces sociétés qui sont fondées sur l'idée de diviser les gens sur la base de la race, de la religion, etc.
David Ibarra Bedoya:
En vous écoutant, je voudrais reprendre une phrase qui résume, je crois, très bien cette marginalisation des gens pas blancs, soient-ils noirs, indigènes, etc. : « Comme d'habitude le chauffeur m'a mise près de lui à l'avant, à la place réservée aux voyageurs blancs. » (Inégalité), cet exemple se trouve à la page 16.

La marginalisation de race est très présente dans le livre. Dans ce cas, on peut voir comment la race lui donnait une certaine place dans le bus, et comment d'elle dépendait de sa position dans la société. On était moins si on était noir, indigène ou métis. Par exemple, dans le livre, l'amour qui fleurit entre la protagoniste et le chinois est presque un « scandale inavouable », on peut dire que c'est seulement parce qu'il était chinois et n'était pas au niveau des gens blancs. La protagoniste dit : « Il devient devant mon frère un scandale inavouable, une raison d’avoir honte qu’il faut cacher » (Marginalisation) (page 67).
Dans le livre la marginalisation n'est pas seulement par la race, mais par l'argent aussi. Pendant tout le livre il y a une très grande différence entre les riches et les pauvres, et la protagoniste l'exprime avec son amant : « Je lui raconte comme c'était simplement si difficile de manger, de s'habiller, de vivre en somme, rien qu'avec le salaire de ma mère. » (Inégalité) (Page 58) On pourrait dire que c'est un thème d'inégalité entre le salaire d'une femme et un homme, ou peut-être c'était à cause du travail que la mère avait. En général, tout le livre est plein de ces situations d'inégalité et de marginalisation, on pourrait en tirer des milliers des exemples, voici un dernier : « C'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Saigon, ces grandes voies à l’américaine sillonnées par les tramways, les pousse-pousse, les cars. » (Inégalité) (Page 46 - 47)

On peut dire que, dans le livre, l'inégalité ne concerne pas seulement la quantité d'argent dont dispose une famille, mais aussi les lieux où les gens vivent et, au final, la qualité de vie qu'ils ont.
D'autres exemples tirés du livre
On vous présente de bons exemples tirés du livre dans lesquels vous pouvez voir comment la marginalisation et l’inégalité sont narrées dans l’histoire :
« Comme d'habitude le chauffeur m'a mise près de lui à l'avant, à la place réservée aux voyageurs blancs. » (Marginalisation e inégalité)
« C'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Saigon, ces grandes voies à l’américaine sillonnées par les tramways, les pousse-pousse, les cars. C'est tôt dans l'après-midi. Elle a échappé à la promenade obligatoire des jeunes filles du pensionnat. » (Inégalité)
« Je lui raconte comme c'était simplement si difficile de manger, de s'habiller, de vivre en somme, rien qu'avec le salaire de ma mère. » (Inégalité)
« La population ici aime bien être ensemble, surtout cette population pauvre, elle vient de la campagne et elle aime bien vivre aussi dehors, dans la rue. » (Marginalisation et inégalité)
« Je lui dis que moi aussi j’aurais bien aimé habiter dans une galerie extérieure, que quand j’étais enfant cela m’apparaissait comme un idéal, être dehors pour dormir. » (Inégalité)
« C'est comme s'il n'était pas visible pour eux, comme s'il n'était pas assez dense pour être perçu, vu, entendu par eux. » (Marginalisation)
« Il devient devant mon frère un scandale inavouable, une raison d’avoir honte qu’il faut cacher. » (Marginalisation)
« La directrice a accepté parce que je suis blanche et que, pour la réputation du pensionnat, dans la masse des métisses il faut quelques blanches. » (Marginalisation e inégalité)
Merci de nous avoir écouté pendant toute cette table ronde. On a parlé du livre « L’Amant », écrit par Marguerite Duras, on a exprimé notre point de vue et aussi analysé comment la marginalisation et l’inégalité sont y démontrées. À la prochaine.